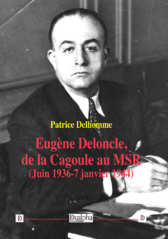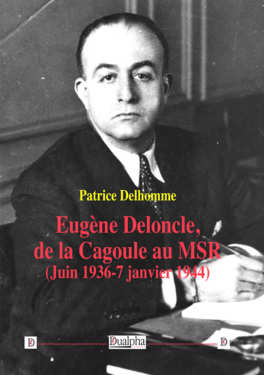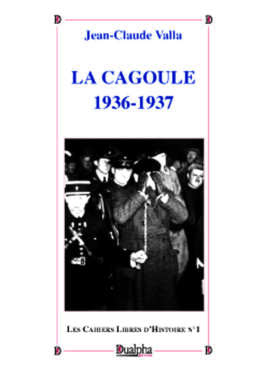|
| |
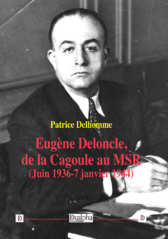 |
|
Comment en êtes-vous venu à vous intéresser à la Cagoule et à son créateur et dirigeant Eugène Deloncle ? Comme beaucoup, j’avais entendu parler de cette organisation à laquelle s’attache une réputation sulfureuse. Car, dès que l’on prononce le mot « Cagoule », aussitôt l’imaginaire renvoie au Ku Klux Klan, à l’Inquisition, à la Sainte Vehme et aux témoins à brevet du temps de la Fronde. Si, en plus, viennent s’y ajouter des anecdotes de caves aux murs tournants, bourrées d’armes, et, en plein milieu du XXe siècle, des histoires d’exécutions par le poignard et le poison, qui rappellent les méthodes utilisées par les Carbonari un siècle plus tôt, alors incrédulité et curiosité s’entremêlent. Mais, c’est au cours de recherches au sujet de l’évolution de l’armement du fantassin, entraînée par la guerre de 14-18, qu’en m’intéressant au retour de la grenade sur le champ de bataille après une absence de plusieurs siècles, qu’un collectionneur de munitions, au milieu de projectiles de la Ire guerre mondiale, m’a montré un modèle, quelque peu postérieur, provenant d’un dépôt de la Cagoule. La facture industrielle de l’objet excluait toute fabrication artisanale. Une rapide enquête permettait d’apprendre que la fabrication en avait été considérable, puisque plus 6 000 de ces grenades, saisies à la fin de 1937, avaient entraîné une catastrophe, se traduisant par quatorze morts, à la suite d’une erreur de manipulation, au dépôt de Villejuif du Laboratoire Municipal de Paris. Une telle prouesse industrielle clandestine paraissant incroyable, j’ai voulu en savoir plus sur la mystérieuse organisation. Il existait de nombreux articles de presse et plusieurs livres sur la question. Mais à l’occasion de la narration d’une aventure, déjà délirante en elle-même, dans sa simple réalité, beaucoup en profitaient pour en rajouter. Pour des raisons politiques évidentes ou pour se donner de l’importance : « Les véritables chefs de la Cagoule étaient le maréchal Pétain, Pierre Laval et Marcel Déat » (Joseph Désert), « Les Cagoulards étaient 40 000 » (Philippe Bourdrel) et même « 120 000 » (Annie Lacroix-Ruiz). Par contre, Jean-Claude Valla, dans son ouvrage sur la question (La Cagoule, éditions Dualpha) reste toujours sur le terrain de la réalité. Pour faire le tri, par recoupement et pour suivre la chronologie de toute l’affaire, outre quelques archives confidentielles préservées, la presse quotidienne de l’époque restait la source la plus sûre.
|
|
|
|
|
|
| |
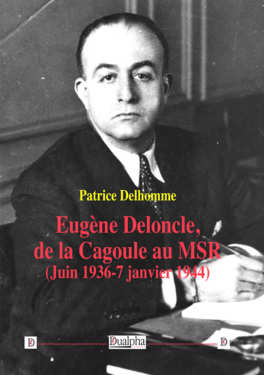 |
|
La Cagoule est-elle parvenue aux portes du pouvoir en 1937 ? L’organisation clandestine s’était certes dotée d’un armement léger très perfectionné, dont 300 pistolets-mitrailleurs, armes dont, à l’époque, ni l’armée ni la police ne disposaient. Elle avait également inventé un modèle très novateur de grenade dont elle manufactura industriellement environ 20 000 exemplaires. Cependant, tous les recoupements indiquent que ses effectifs n’ont jamais dépassé les 2 000 activistes, essentiellement sur Paris et sa banlieue ouest. De plus, leur âge moyen se situait autour de la cinquantaine, ce qui implique une nette baisse de la pugnacité sur le terrain et ce qui exclut alors d’entrée tout espoir de mener un coup d’État à froid. Mais surtout, un mois à peine après sa création, le groupe a été dénoncé par ses anciens camarades : dès le 11 juillet 1937, Charles Maurras, écrit dans L’Action française : « De dix côtés différents, nous avons été mis au courant d’une intrigue secrète, ou qui se croit telle. Elle prend de grandes précautions pour affecter de se couvrir. Aussi parle-t-on partout de serments pseudo-maçons. » En novembre 1936, dans Le Flambeau, l’hebdomadaire du PSF, le colonel de La Rocque lance à son tour : « Des renseignements indiscutables, nous parviennent de différentes sources sur la création, à Paris et en Province, d’organisations formées sous le nom de groupements d’autodéfense, ou tout autre vocabulaire analogue. Nous mettons très nettement nos amis en garde contre les agissements provocateurs que cachent fréquemment ces initiatives. » En janvier 1937 un courrier, adressé à la Sureté, sans doute par l’Action Française, désigne trois de ses transfuges, Deloncle, Jeantet et Corrèze comme les chefs de la nouvelle organisation secrète. Grâce à l’ancien inspecteur Bonny, la Sureté parviendra à infiltrer des agents, hommes et femmes, à l’intérieur de l’organisation. L’un d’eux était le propre neveu de l’inspecteur, Jean-Damiens Lascaux, qui le suivra plus tard à la Gestapo de la rue Lauriston. Mais surtout Bonny arrivera à glisser auprès d’Eugène Deloncle et de François Méténier un certain Thomas Bourlier qui saura se faire passer pour un agent du 2e Bureau chargé d’assurer la liaison entre la Cagoule et son administration. Le gouvernement sera donc pratiquement tenu au courant au jour le jour de chacune des actions et des projets de la Cagoule. À chaque fois que les autorités auront besoin, dans des périodes délicates, de rallier rapidement l’opinion publique elles révéleront un pan du complot. Et, lorsque la Cagoule aura l’idée de se lancer, à l’Étoile, dans des attentats sous fausse bannière (le 11 septembre 1937), en un mois, tous les dépôts d’armes, bien que très soigneusement dissimulés, seront vidés, par des policiers dotés d’un flair incroyable et tous les dirigeants de l’organisation arrêtés.
|
|
|
|
|
|
| |
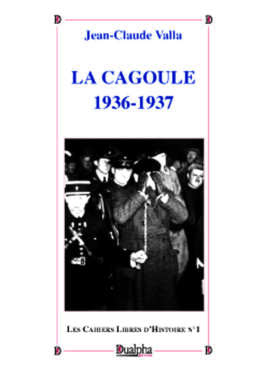 |
|
Pendant plus de trois décennies, à intervalle régulier, François Mitterrand a été désigné comme un ancien membre de la Cagoule. Cette rumeur a été diffusée en 1954, alors que Mitterrand venait d’être nommé ministre de l’Intérieur, par le nouveau président du Conseil Pierre Mendès-France. C’est une petite feuille d’informations confidentielle, Lettre à un cousin, qui lance le scoop. Tenue par Jean-André Faucher, un ancien inspecteur régional du PPF, généreusement approvisionnée en informations exclusives par les RG, la petite publication est lue avec avidité par tout le monde politique. Elle affirme, dans son numéro de juillet 1954, qu’ayant pu enfin consulter la fameuse Liste Corre, rédigée par la Cagoule en 1937 pour inventorier la totalité de ses militants, certains policiers, certifient y avoir lu en toutes lettres le nom de leur nouveau ministre. Une série de coïncidences troublantes semblent confirmer le renseignement : au lycée, François Mitterrand a eu pour condisciples Pierre de Bénouville et Jean-Marie Bouvyer, futurs membres de l’organisation secrète. En 1939, son frère Robert épouse Édith Cahier, la sœur de Mercédès, la femme d’Eugène Deloncle. La sœur de François Mitterrand, Marie-Josèphe, artiste peintre, entretiendra de 1941 à 1947 une liaison avec Jean-Marie Bouvyer, l’un des acteurs de l’opération Rosselli. Plus tard, à la naissance de son fils Jean-Christophe, le futur président lui choisira pour marraine la mère de Jean-Marie Bouvyer. Cette réputation cagoularde, sorte de tunique de Nessus politique, suivra Mitterrand tout au long de sa carrière. Dès 1954, à l’occasion de l’Affaire des fuites, le député Jean Legendre, ancien du PSF et le député gaulliste Raymond Dronne relayent l’accusation en pleine Assemblée. Même en 1984, pour être revenus sur l’affaire, les députés Alain Madelin, ancien d’Occident, François d’Aubert de l’UDF et Jacques Toubon du RPR, sont punis d’un mois de suspension d’indemnités parlementaires. Les moindres signes paraissent comme de nouvelles preuves : en 1985, c’est sous sa présidence que Paul Collette, qui avait pistoletisé d’un seul chargeur de 6,35 Pierre Laval et Marcel Déat, reçoit la Légion d’honneur. Une rumeur infondée, avait à l’époque, brièvement, présenté le normand comme envoyé par Eugène Deloncle. Paul Collette, avait été jusqu’alors tenu à l’écart des honneurs. Indice supplémentaire, en 1988, Mitterrand assistera aux obsèques de Mercédès Deloncle. Sur la fameuse Liste Corre, qui à la lettre « M » comporte une soixantaine de noms, allant d’Alfred Macon à Roger Muraciole, le nom de l’ancien président de la République aurait dû figurer entre celui de Mitjaville de Perpignan et celui de Moch de Paris 17e, or il n’y a jamais été inscrit. Issu d’un milieu aisé, conservateur et catholique pratiquant, qui envoie ses enfants dans de bonnes écoles et qui, à Paris, en 1937, fréquente les mêmes réceptions, les mêmes restaurants à la mode et les toutes dernières expositions, François Mitterrand, aura eu forcément maintes occasions de croiser parmi ses amis et dans son entourage proche des membres du CSAR. Car, à l’époque, l’appartenance à l’organisation était, en quelque sorte, presque devenue une des caractéristiques de la bonne société, associée à la vie mondaine de cette dernière. Enfin, alors que la moyenne d’âge du Cagoulard se situe autour de la cinquantaine, c’était toujours la petite minorité de jeunes gens, n’ayant pas connu la guerre, qui représentait les éléments les plus durs, chargés des opérations radicales. Âgé de 21 ans en 1937, François Mitterrand, aurait, presque obligatoirement été engagé dans une opération ayant laissé quelques traces.
|
|
|
|
|
|
| |
Eugène Deloncle, de la Cagoule au MSR (juin 1936-7 janvier 1944), Patrice Delhomme, éditions Dualpha, 358 pages, 31 euros. Pour commander ce livre, cliquez ici. La Cagoule 1936-1937, Jean-Claude Valla, éditions Dualpha, 148 pages, 23 euros. Pour commander ce livre, cliquez ici.
|
|
|
|