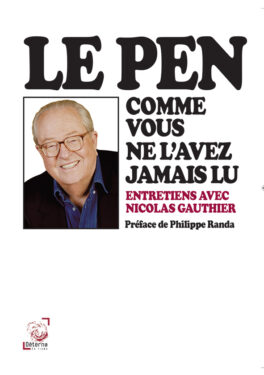| |
« Économiquement de droite et socialement de gauche »
| |
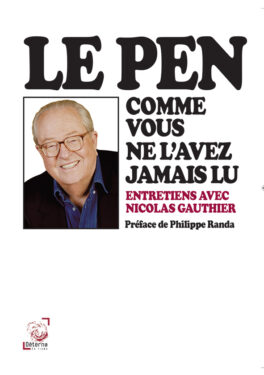
|
Peu de journalistes ont aussi bien connu Jean-Marie Le Pen. Comment le définiriez-vous politiquement, dans quelle famille, dans quelle tradition ? Comment définir cet homme qui répugnait souvent à se définir ? Pour lui, se définir équivalait un peu à se limiter. Voilà peut-être pourquoi les réponses qu’il donnait à cette question étaient souvent contradictoires. Ainsi, s’est-il, au fil du temps défini comme « national-libertaire », « économiquement de droite et socialement de gauche », allant même jusqu’à se présenter comme une sorte de « Reagan français ». Il est vrai que c’était l’époque de la Guerre froide et que le parcours d’un Ronald Reagan n’était pas forcément pour lui déplaire : acteur de seconde zone, syndicaliste, venu tard en politique et en proie au mépris généralisé des élites américaines. Une fois je lui avais dit que, dans le fond, il était une sorte de « hippie d’extrême droite », ce qui l’avait fait beaucoup rire. Plus sérieusement et si l’on s’en tient aux trois droites de René Rémond, légitimiste, orléaniste et bonapartiste, on peut dire qu’il appartenait plutôt à la troisième. Une sorte de patriote populiste, en quelque sorte, mâtiné d’un brin de légitimisme, quoiqu’il ait toujours été un républicain farouche, n’hésitant pas à souvent moquer l’indécrottable royaliste que je suis. Tant de gens lui reprochaient de ne pas être un « véritable républicain » ; moi, je lui reprochais surtout de l’être trop. Et humainement ? Un homme dont l’immense gentillesse pouvait parfois confiner à la naïveté. Je crois qu’il aimait sincèrement les gens, cherchait à les comprendre ; surtout ceux qui ne partageaient pas ses idées. En revanche, en bon Breton, il était capable d’entrer subitement dans des colères tonitruantes, pour redescendre sur terre quelques minutes plus tard, ayant tout oublié des raisons de son énervement. Que dire de plus ? Si, Le Pen était d’une curiosité intellectuelle insatiable. Était-il, selon vous, trop à l’étroit dans les habits neufs de la vieille droite ? Qu’est-ce qu’il lui reprochait ? Ce qu’il reprochait à la droite ? Son étroitesse d’esprit, justement. Son combat ne consistait pas à sauver la droite, mais à sauver la France. Il n’en avait que faire de la droite. Il la méprisait autant qu’elle le méprisait, lui. Quand il affirmait que « Chirac, c’est Jospin en pire », il faut le croire. Jospin, socialiste et qui se conduisait comme tel, il respectait. Mais un Chirac qui se faisait passer pour un homme de droite, ça le mettait hors de lui. Le « ni droite ni gauche » de Marine Le Pen ne sort pas de nulle part, de même de la dédiabolisation. Pour vous, y a-t-il continuité – ou rupture – entre le lepénisme et le marinisme ? Qu’est-ce que la fille doit au père – et qu’est-ce que le père doit à la fille ? Et qu’est-ce qui les éloigne, exception faite des chiens et des chats ? Ce « ni droite ni gauche » ne sort effectivement pas de nulle part, s’agissant de l’essai éponyme que nous avions écrit avec Samuel Maréchal en 1995. N’oubliez pas qu’après l’élection présidentielle de 1995, le Front national est le premier parti de ce qui demeure de classe ouvrière. Il faut donc revoir le logiciel lepéniste d’antan de fond en comble. Notons qu’il ne s’agit pas là d’un simple principe d’opportunité. La seule erreur, c’est peut-être le titre. Comme me l’avait fait remarquer Alain de Benoist, mieux aurait valu qu’il s’appelle « Et de droite et de gauche ». En ce sens, il y a donc continuité entre le père et la fille. Tout comme la « dédiabolisation » du FN et son changement de nom, toutes mesures à l’origine initiées par Jean-Marie Le Pen, participe de cette « continuité ». En politique étrangère, le qualifieriez-vous de gaulliste ? L’Europe de Brest à Vladivostok, l’alliance avec la Russie, Poutine ou pas, l’indépendance vis-à-vis de Washington, la critique de la politique israélienne et du suivisme français dans les conflits américains – on pense à la première guerre du Golfe… Qui aujourd’hui assumerait à droite de telles positions. Ne serait-ce pas ce qui manque aujourd’hui le plus cruellement aux droites ? Gaulliste, je ne sais pas. Mais gaullien, assurément. Son entourage de l’époque était très antigaulliste, à l’exception de Roger Holeindre et de Roland Gaucher. L’un avait pourtant échappé de peu aux prisons gaullistes pendant la guerre d’Algérie ; l’autre en avait longuement tâté en 1945. Mais ils n’en voulaient pas plus que ça à l’homme du 18 juin. Quant à Jean-Marie Le Pen, tout cela était pour lui de l’histoire ancienne. Alors oui, il était gaulliste à sa façon, tant il est vrai qu’il n’est pas forcément besoin de se revendiquer du gaullisme pour défendre les intérêts de la France. Jacques Bainville faisait ça très bien, longtemps avant De Gaulle. Jean-Marie Le Pen aurait pu dire comme Verdi : « Ma gloire est une cathédrale de crachats ». Ce qui n’était pas pour lui déplaire. Ne l’avez-vous jamais senti accabler par l’incompréhension ? Certes, cela correspondait à son goût du combat, même perdu d’avance. Pourtant, cette posture a pu l’isoler et lui coûter le pouvoir. Pensez-vous qu’il ait accepté cette marginalisation, ou l’a-t-elle secrètement rongé ? Ce n’est pas parce que l’on est proche de quelqu’un qu’on peut sonder les tréfonds de son cœur. Oui, je crois qu’il souffrait d’être ainsi relégué au banc de l’infamie, mais qu’il s’en faisait une raison, mais également une gloire. Bien sûr, qu’à l’instar de tout un chacun, il aurait aimé être plus aimé. Mais il avait aussi ce don de ne point aimer ceux qui ne l’aimaient pas, ou plus. Je crois que l’opinion de ses amis lui importait plus que celle de ces ennemis. Et des amis, il en avait beaucoup. Avec le recul, quel est selon vous son véritable héritage politique ? Avoir montré que tout demeurait possible, que le pire n’était jamais certain et qu’en politique, le désespoir était sottise absolue, tel qu’écrit par un Charles Maurras qui faisait également partie de ses innombrables lectures.
Nicolas Gauthier, Le Pen comme vous ne l’avez jamais lu, entretiens avec Jean-Marie Le Pen, préface de Philippe Randa, Éditions Déterna, 2025, 158 p., 21 €.
Extrait de la préface de Philippe Randa : « Au fil de ces entretiens qui, selon l’expression consacrée, « n’ont pas pris de ride » et restent d’une étonnante pertinence, Jean-Marie Le Pen aborde de multiples autres sujets – car, au risque de surprendre encore tous les thuriféraires de l’anti-lepénisme, le quintuple candidat à l’élection présidentielle a eu bien d’autres préoccupations, abordé bien d’autres enjeux dans sa vie politique que le racisme, l’antijudaïsme et la iie Guerre mondiale… Que ce soit sur la famille, l’école, la culture, le travail, les libertés individuelles, les manipulations génétiques, la souveraineté de la France… ou bien encore les États-Unis d’Amérique pour lesquels il « éprouve une grande admiration », tout en sachant que « nos intérêts et les leurs ne coïncident pas forcément », l’Afrique dont il fut l’un des premiers à avoir voulu effacer la dette et dont il a toujours persisté à penser « (avoir) eu raison, il y a vingt ans, de proposer cette mesure de salut public, de salut planétaire »…
|
|