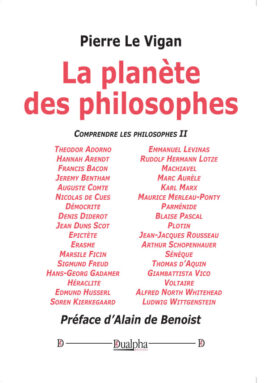| |
« Comprendre les philosophes II : La philosophie a aujourd’hui un statut assez étrange. Elle est essentiellement le fait des enseignants du secondaire et des chercheurs spécialisés. Les enseignants cherchent à familiariser leurs élèves avec des concepts et des problématiques auxquels ils ne comprennent pas grand-chose, ce qui donne à la philosophie la réputation d’une matière très ennuyeuse. Les chercheurs, cooptés par leurs pairs, organisent des colloques en milieu clos et publient des articles dans des revues qu’à part leurs collègues personne ne lit.
À côté de cela, on trouve une philosophie grand public, une sorte de “philosophie pour les nuls”, où certains auteurs à la mode s’emploient à décrire de vagues notions philosophiques pour en faire un outil d’“épanouissement personnel”. Rien de bien enthousiasmant dans tout cela… alors que la philosophie est d’abord une façon d’être et une façon de penser.
La philosophie permet le travail de la pensée. La philosophie n’est pas un domaine de la pensée, et moins encore une matière scolaire, elle est le fondement de toute pensée. C’est en cela qu’elle est indispensable. »
| |
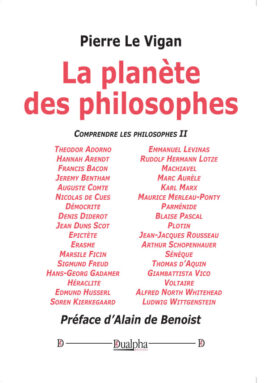 |
Pourquoi vous êtes-vous lancé dans cette vaste enquête sur les philosophes ? Vous n’avez pas tort de parler d’enquête. Ce terme veut dire recherche de la vérité, et ce par recoupements et avec rigueur. J’ai souhaité proposer un outil, qui est en somme un manuel, pour aborder la pensée de philosophes importants. Avec les deux volumes, Comprendre les philosophes (26 auteurs) puis La planète des philosophes (34 auteurs), ce sont quelque 60 philosophes, parmi les plus importants, voire les plus importants, qui sont abordés. L’idée est de faire comprendre en peu de lignes les axes essentiels de leur pensée. C’est donc avant tout un travail de synthèse. Quelles sont vos propres positions philosophiques ? On voit en lisant mon avant-propos que je suis porté vers les positions du monisme. Cela veut dire que je trouve réducteur le dualisme corps-âme, corps esprit, substance pensante substance étendue, voire le dualisme individu et communauté, homme et patrie (on pourrait mettre « patrie » au pluriel au sens où une petite patrie peut être incluse dans une plus grande patrie). On verra aussi que je suis peu convaincu par les conceptions créationnistes de l’univers et de l’homme. Cela amène à souligner les liens entre philosophie et pensée religieuse. Les monothéismes séparent ce qui est éternel de ce qui est créé. C’est une position que je ne partage pas. Cela suppose un dieu extérieur au monde. Je me réfère au contraire à des dieux dans le monde et partie prenante du monde. Je crois en d’autres termes que la clé de compréhension du monde et de sympathie avec le monde (la sympathie permet de comprendre) se trouve dans le polythéisme (le monothéisme païen me paraissant une parenthèse tardive). Le monde me parait à lui-même sa propre cause, et contient en lui sa propre pluralité et ses propres métamorphoses. En ce sens, le chien (comme catégorie d’animal) existe parce qu’il n’existe pas qu’un seul chien sur terre, et l’univers existe parce qu’il y en a plusieurs. Donc, de mon point de vue, on ne peut distinguer un créateur et sa création. À ce propos, on peut noter que la question de savoir si les Grecs croyaient à leurs dieux reste ouverte (Paul Veyne). Il est néanmoins certain qu’ils n’y croyaient pas comme on croit en un Dieu monothéiste et extérieur au monde. Ce Dieu des monothéismes a essayé de remplacer le tragique par la sotériologie. Je pense pour ma part que la nature est cause d’elle-même, que la matière est cause de l’esprit, que l’homme s’inscrit strictement dans la chaîne de la vie. Pour faire court, je suis moniste et matérialiste, comme Diderot ou La Mettrie, et, avant eux, comme Epicure et Lucrèce. Peut-être aussi comme les écrivains Pierre Gripari, Michel Tournier, Jacques Laurent (tous de formation philosophique). Comment définiriez-vous la philosophie ? On a souvent dit que la philosophie était le stade supérieur de la pensée. C’est le domaine de la pensée qui pose la question du sens, et qui pose la question des valeurs. Pour cela, la philosophie a développé toute une série d’analyses « techniques » (raison pure, impératif catégorique, dialectique…). Elles peuvent amener la philosophie à se perdre et à devenir une philosophie pour accélérer les carrières des philosophes universitaires (un travers qu’il ne faut pas généraliser). Ce n’est évidemment pas cela qui est intéressant. La philosophie est pour moi la pensée qui se maintient au plus haut niveau possible d’honnêteté. En ce sens, il n‘y a pas de philosophie sans une certaine philosophie du soupçon, comme l’avait compris Nietzsche. Cela ne veut, bien sûr, pas dire qu’il faille tomber dans la paranoïa ! Que pensez-vous des différentes tentatives d’élaborer une philosophie de droite ? Il n’y a évidemment pas de « philosophie de droite » ou de « philosophie de gauche » (quelle droite ? Quelle gauche ?). Il peut y avoir par contre des pensées de droite (ou de gauche). Elles peuvent être – ou pas – de qualité sans être philosophique. Une tendance contemporaine est de voir de la philosophie partout. Prenons la pensée de l’enracinement défendue notamment par Simone Weil (1943). Ce n’est pas à proprement parler une position philosophique, mais c’est une position politique, sociologique et anthropologique. Je le dis d’autant plus que je la partage entièrement. Un thème proprement philosophique est la discussion sur le degré de malléabilité de l’homme, thème qui se trouve en amont de la question de l’enracinement, mais ne se confond pas avec elle. Une autre discussion proprement philosophique est celle de l’origine des idées : sont-elles innées (Descartes) ou viennent-elles de l’expérience sensible (Hume) ? Nous sommes ici au cœur de la philosophie. Ne cachons aucunement que cela demande des efforts et beaucoup de travail. On le voit : tout point de vue n’est pas philosophique, et il peut néanmoins être intéressant. Il est toutefois rare qu’un point de vue argumenté n’ait pas un soubassement philosophique. Il est alors utile d’avoir les outils intellectuels pour le comprendre et l’éclairer. De même, tout propos d’un philosophe n’est pas un propos philosophique – ce que l’on oublie la plupart du temps ! À l’inverse, un non-philosophe peut soulever une question philosophique. Par exemple, quand Jean-Yves Le Gallou s’interroge sur le réchauffement climatique et se demande si la notion de température moyenne du globe (le fameux propos « la terre se réchauffe ») a un sens, il pose une question épistémologique, donc philosophique. On voit que la philosophie, c’est tout simplement la pensée prise au sérieux ! La planète des philosophes (Comprendre les philosophes II), de Pierre Le Vigan, Préface d’Alain de Benoist, Éditions Dualpha, 274 pages, 31 €.
|
|