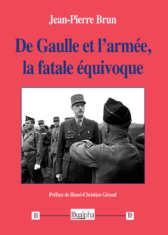|
Pourquoi les cadres de l’armée vont-ils s’opposer à cette politique ? Réaction spontanée d’une entité bâtie sur le strict concept de la défense de la Nation et de la grandeur de son destin colonial ? Réflexe de vieilles culottes de peau incapables de voir plus loin que la visière de leur képi ? L’armée de métier vient de vivre au plus profond de sa chair l’affaire vietnamienne, la pusillanimité, la lâcheté des politiques, l’abandon des populations locales, l’ignominie de la guerre révolutionnaire et les cortèges de massacres qu’elle suscite. Bien qu’elle soit la Grande Muette, elle n’est ni sourde ni aveugle. De ce fait et bien avant les gouvernements instables qui jalonnent l’histoire de la IVe République, elle a pu mesurer le poids, tant de Moscou que de Pékin, dans le destin de la péninsule indochinoise, mais aussi le jeu sournois de Washington. Elle a compris qu’à simplifier les problèmes et à les réduire à une joute bilatérale, on s’interdisait toute projection dans le temps permettant d’anticiper d’autres menaces. Le 15 novembre 1957, devant un aréopage étoilé du SHAPE, le général Allard brossait déjà un tableau inquiétant de la situation : « En 1956, la France et la Grande-Bretagne avaient voulu s’opposer au déferlement vers l’Ouest du panarabisme encouragé par le communisme. Le monde libre n’a pas compris la portée de ces tentatives et ce furent des échecs. La ligne de défense arrière, la dernière, passe par l’Algérie. » C’est ce qui, après bien d’autres de ses pairs, conduira le général Challe à se confier ainsi à un journaliste de Barcelone : « La sécurité du monde occidental impose à la France la permanence en Algérie. Ce que représente l’Algérie n’est qu’une bataille dans l’immense conflit où se débat aujourd’hui le monde libre. L’avenir de l’Europe s’y joue […] Il y aura la misère. Cela nous coûtera probablement plus cher qu’aujourd’hui et l’exploitation de cette misère se fera contre qui ? Bien évidemment contre la France. » C’est donc cette conviction qui va entraîner les chefs militaires français à renâcler sinon à s’opposer ouvertement à la politique du chef de l’État. Les positions du Général et de ses détracteurs étant aussi tranchées, pourquoi parler d’équivoque ? En fin et rusé politicien, de Gaulle, pour imposer sa politique, va utiliser au départ de Mostaganem (« Vive l’Algérie française ») un chemin particulièrement louvoyant pour mieux les perdre. Le plus simple est de le laisser s’exprimer : « Quant à la tactique, je devais régler la marche par étapes, avec précaution. Ce n’est que progressivement, en utilisant chaque secousse comme l’occasion d’aller plus loin, que j’obtiendrais un courant de consentement assez fort pour emporter tout. » De là à susciter ces providentielles secousses il n’y avait qu’un pas, habilement franchi par celui qui par ailleurs qualifiait de « foutaise » l’idée même d’une guerre subversive. C’est cette progression tortueuse que cet ouvrage s’emploie à reconstituer.
Entretien avec Jean-Pierre Brun, auteur de De Gaulle et l’armée, la fatale équivoque, éditions Dualpha, collection « Vérités pour l’Histoire », Préface de Henri-Christian Giraud, 232 pages, 25 euros.
|